Avril Ventura nous parle de son livre La meilleure part d’eux-mêmes, publié chez Alma Editeur.
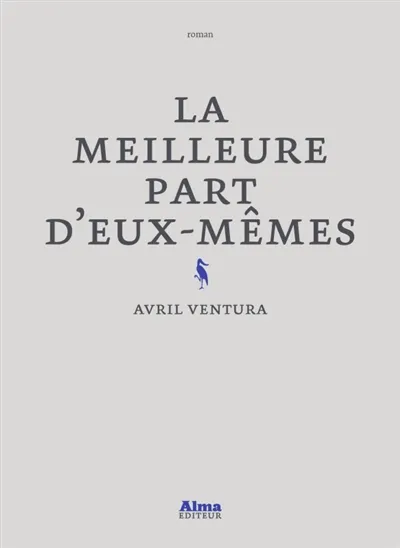
Avril Ventura vit à Paris.
Après des études de lettres modernes et une première collaboration aux Inrockuptibles, elle écrit pour les pages littéraires du Monde et du magazine Elle, et travaille à France Culture comme productrice adjointe.
2008 – Ce qui manque, coll. Fiction & Cie, éditions du Seuil
2024 – La Meilleure part d’eux-mêmes, éditions Alma
Lire aussi cet Article… Entretien avec Emmanuelle Grondin
Acheter le livre Ici… La meilleure part d’eux-mêmes De Avril Ventura
INTERVIEW
Parlez-nous de vous. Qui est réellement Avril Ventura ?
C’est une question assez vertigineuse, à laquelle je vais donc tenter de répondre par des faits concrets. Je suis adjointe à la production à France Culture, c’est à dire que j’aide à préparer l’émission d’éducation Être et savoir de Louise Tourret. À côté je suis critique littéraire pour le magazine Elle et Le Monde des livres. J’ai un DEA de Lettres modernes, et si j’ai encore du mal à me dire écrivaine, je me définirais avant tout comme une lectrice, je crois que le désir d’écrire vient toujours de là.
Nous vous recevons pour votre deuxième roman. Qu’est-ce qui vous a donné envie de l’écrire ?
J’ai commencé à écrire ce deuxième roman dès la sortie du premier, en 2008… J’ai d’ailleurs eu une bourse du CNL d’après les premières pages, qui n’existent plus aujourd’hui : au départ c’est le personnage de Paul qui existait, et je pensais faire un roman polyphonique comme c’était le cas pour Ce qui manque. Mais je me suis retrouvée bloquée par des éléments qui n’étaient pas intervenus dans la rédaction du premier, qui est toujours un peu un « coup de poker » : beaucoup plus de doutes, d’autant que mon travail de journaliste littéraire s’était développé, je n’arrivais plus à écrire sans me juger immédiatement. J’ai abandonné et repris le projet pendant plusieurs années, avant de retrouver enfin le plaisir d’écrire en partant de Marie cette fois : c’est elle qui a soudainement débloqué les choses. Mais il y avait une nécessité qui faisait que j’y revenais toujours.
Comment conciliez-vous votre rôle de journaliste, qui rapporte les faits, et celui d’écrivain, qui donne libre cours à son imagination ?
À France Culture je ne suis pas journaliste. À côté je suis journaliste littéraire, ce qui est un peu particulier. Je ne rapporte pas vraiment des faits, mais plutôt mon ressenti suite à une lecture, même si je ne parle que des livres que j’ai aimés : la rédaction, l’analyse, les émotions sont en jeu, ce n’est donc pas si loin du travail d’écriture. En revanche, il est vrai que le travail de critique a pu me poser problème à certains moments : soit je lis des choses exceptionnelle et je me dis que je ne suis pas à la hauteur, soit je lis des choses qui me semblent moins bonnes et je me dis que ce n’est pas la peine d’ajouter une publication « moyenne » à tout ce qui est publié…
Cela dit, la question qui se pose entre fiction et réel est passionnante, mais pour d’autre raisons. Il n’y a jamais la réalité d’un côté et de l’autre l’imagination pure. Quand un auteur publie on s’interroge trop à mon goût, surtout les proches, sur ce qui est vrai ou pas. Selon moi ce n’est pas intéressant pour les raisons que l’on pense : ce qui l’est c’est le processus extrêmement complexe et subtil qui mêle les deux et que bien souvent un auteur lui-même ne parvient pas à démêler. Je pars souvent d’un fait ou d’une émotion réels, vécus par moi ou quelqu’un d’autre, mais il y a toujours un moment où le réel est essoré ou amplifié, distordu, transformé pour donner autre chose, sans que je puisse forcément dire précisément après coup à quel moment la transformation a eu lieu, ni comment, ni pourquoi.
C’est ce que je trouve passionnant, mais cela mériterait un colloque entier ! Je crois beaucoup à la célèbre phrase, probablement apocryphe, de Flaubert, « Mme Bovary c’est moi. » – je la trouve d’autant plus intéressante que la réalité de cette phrase est justement remise en cause, ça dit toute la complexité du sujet !
Pourriez-vous nous dévoiler quelques secrets sur votre processus créatif ? Quels doutes vous animent en tant qu’écrivain, et comment arrivez-vous à les surmonter pour donner vie à vos histoires ?
Si j’avais des secrets créatifs, je les publierais en espérant faire fortune ! Je me méfie d’ailleurs des « recettes » (comme pour l’éducation des enfants), qui ne valent que pour un auteur en particulier et éventuellement à un moment précis. Le seul conseil que j’ai lu dans des interviews d’écrivains et qui a été vraiment porteur pour moi c’est « travaille ! ». Laurent Mauvignier, dont j’admire énormément l’œuvre et qui a eu la gentillesse de lire quelques pages de mon manuscrit, balayait mes doutes du revers de la main et me disait en gros de m’y coller, c’était le meilleur conseil. J’ai d’ailleurs sur mon frigo une citation d’Ernest Hemingway que j’adore et qui dit à Scott Fitzgerald : « Go on and write ».
En gros : « arrête de gémir et mets-toi au boulot ! » Il faut savoir, en revanche, qu’une séance de travail peut aussi être une après-midi, ou une semaine passées à ne pas réussir à écrire… On croit que c’est du temps perdu mais en réalité on avance aussi ainsi, même si c’est dur à comprendre sur le moment. Concernant les doutes, ils sont consubstantiels au travail d’écriture et de création en général. Est-ce que ce que j’écris mérite d’être publié, et lu ? C’est vertigineux. Heureusement, la nécessité d’écrire fait que l’on finit par oublier ses questions, sinon on n’écrit plus…
« La Meilleure Part d’eux-mêmes« , c’est un titre assez énigmatique. À quoi fait-il référence exactement ?
Le titre revient à deux moments dans le récit, et s’est imposé à moi à la fin, ce qui est toujours le cas. Marie pense que l’enfant représente la meilleure part de son histoire avec Paul et je crois que c’est un sentiment assez partagé, à savoir que nos enfants seraient nous « en mieux », mais qui pose beaucoup question à mon sens car il est à double tranchant.
C’est bien sûr une volonté de vouloir le meilleur pour eux, mais c’est aussi une pression sur leurs épaules qui leur retire, je trouve, une part de liberté : les enfants bien sûr sont issus d’une histoire et d’un héritage familial, ils s’inscrivent dans une lignée qui les marque, c’est d’ailleurs aussi ce que raconte le livre, mais il faudrait dans l’idéal leur laisser la place d’être eux-mêmes avant tout et ne pas trop projeter sur eux (évidemment je donne des conseils que je n’arrive pas à appliquer !).
Comment Marie et l’enfant se sont-ils imposés à vous ? Leur lien particulier était-il évident dès le début de l’écriture ?
Comme je l’expliquais plus haut Marie ne s’est pas du tout imposée dès le début puisque j’étais partie sur le point de vue de Paul, au départ. Je ne savais même pas si je lui donnerais la parole (ou un point de vue, puisqu’elle ne parle pas directement, il s’agit d’un narrateur omniscient). En revanche quand elle est apparue, parce que je bloquais et que j’ai voulu essayer autre chose, alors là oui elle s’est réellement imposée, elle a même tout débloqué. Et effectivement dès le début elle m’est apparue avec l’enfant, dans une relation fusionnelle d’où Paul était exclu : Marie n’allait pas sans l’enfant et inversement. J’aimais l’idée de partir d’une équation où il y avait un inconnu.
On a l’impression que Marie s’est réfugiée dans une bulle avec son enfant. Est-ce une façon de se protéger du monde ou plutôt un désir d’échapper à quelque chose ?
Les deux, même s’il y a aussi tout simplement un bonheur réel à la base. Petit à petit on comprend qu’il y a quelque chose de pathologique dans ce mode de fonctionnement, que le père a été d’office exclu de la relation, qu’elle a fait le vide autour d’elle en dehors de sa mère (et encore, elle accepte surtout sa présence par nécessité), mais au départ il y a un moment privilégié que chaque parent peut ressentir à l’arrivée d’un enfant, avec tout l’émerveillement qui l’accompagne.
J’aimais l’idée d’un bonheur parfait qui commençait à se fissurer à un moment, avec l’arrivée de la peur qui survient aussi nécessairement quand on devient parent, et qui se matérialise ici en une odeur suspecte que Marie ne parvient pas à identifier. Tout se fissure à ce moment-là, et effectivement on comprend qu’elle cherche à échapper à quelque chose. J’aimais aussi l’idée que Marie mette tout le récit à comprendre qu’elle fuit quelque chose, qu’elle le saisisse en même temps que le lecteur, dans le temps « réel » de la lecture.
Les relations entre Marie et Élisabeth sont complexes. Comment avez-vous construit cette dynamique familiale ?
La relation entre Marie et Élisabeth était complexe dans mon esprit dès le départ, d’autant que Marie a perdu son père assez jeune, elle a donc grandi en tête à tête avec sa mère. Quand on a un enfant quelque chose se rejoue de sa propre enfance et rebat les cartes avec ses propres parents, c’est ce qui m’intéressait. On suit cette évolution au cours du roman, au fur et à mesure que l’enfant grandi, ça bouge beaucoup, rien n’est figé, malgré les tensions de départ. Le risque était de faire d’Élisabeth un personnage trop caricatural (les mères sont toujours les coupables idéales !).
Au final je crois qu’on comprend les résistances de chacune, et comment elles arrivent à se rencontrer autour de l’enfant. C’est lui qui fait bouger les choses, en négatif mais aussi en positif, l’enfant est pour Élisabeth et Marie un point de tension mais aussi un lieu de retrouvaille.
Votre premier roman, Ce qui manque, parlait déjà de l’absence. Est-ce une continuité pour vous avec La Meilleure Part d’eux-mêmes ?
Oui bien sûr c’est une continuité. On pouvait d’ailleurs entendre Ce qui manque comme « Ceux qui manque » et j’aimais bien ce jeu phonétique. Je n’ai pas lâché cette idée que nous sommes aussi la somme de « ce qui nous manque », de tout ce qu’on a perdu, manqué, pas dit ou pas fait. Mais au-delà de la question de l’absence il y a aussi une continuité concernant la peur qui nous habite, la transmission familiale, et le passage à l’âge adulte.
Ce processus long et complexe qui consiste à grandir et qui continue tout au long de la vie même si je me focalise sur des moments symboliquement forts, comme l’adolescence ou la naissance d’un enfant. Cela dit la dynamique familiale est plus apaisée dans ce roman, même si elle demeure problématique – disons que c’est une dynamique qui au final pousse à avancer si on arrive à en dénouer les tensions.
L’instinct maternel est-il une réalité biologique ou une construction sociale ? Dans quelle mesure la culture et l’éducation façonnent-elles les comportements maternels ?
C’est une question très délicate à laquelle je ne suis pas sûre de pouvoir répondre sauf en me basant sur ma seule expérience personnelle et sans risquer d’enfoncer des portes ouvertes… Il faudrait demander à Louise Tourret, chaque numéro d’Être et savoir apporte un élément de réponse. Déjà, je reformulerais en parlant plutôt d’instinct « parental », car pour moi c’est la même question pour le père ou la mère, et toute distinction entre l’importance de l’un ou de l’autre me semble pour le coup être une constructions sociale.
En revanche je crois beaucoup au poids de l’éducation, c’est plus elle à mon avis qui va faire que le lien se fait ou pas dès le départ avec l’enfant, en fonction de ce que l’on a vécu avec ses propres parents. Mais là encore, rien d’indépassable, heureusement ! On n’est jamais condamné à répéter les mêmes erreurs, ce qui est passionnant dans le fait de devenir parent, c’est qu’on va en commettre d’autres, que nos enfants tenterons d’éviter à leur tour…
Entretien réalisé le 07 septembre 2024
#AvrilVentura #LaMeilleurePartDEuxMêmes #AlmaEditeur #RomanFrancais


















Laisser un commentaire