Dorothée-Myriam Kellou, journaliste et réalisatrice, nous parle de son livre ‘Nancy-Kabylie’ publié chez Grasset.
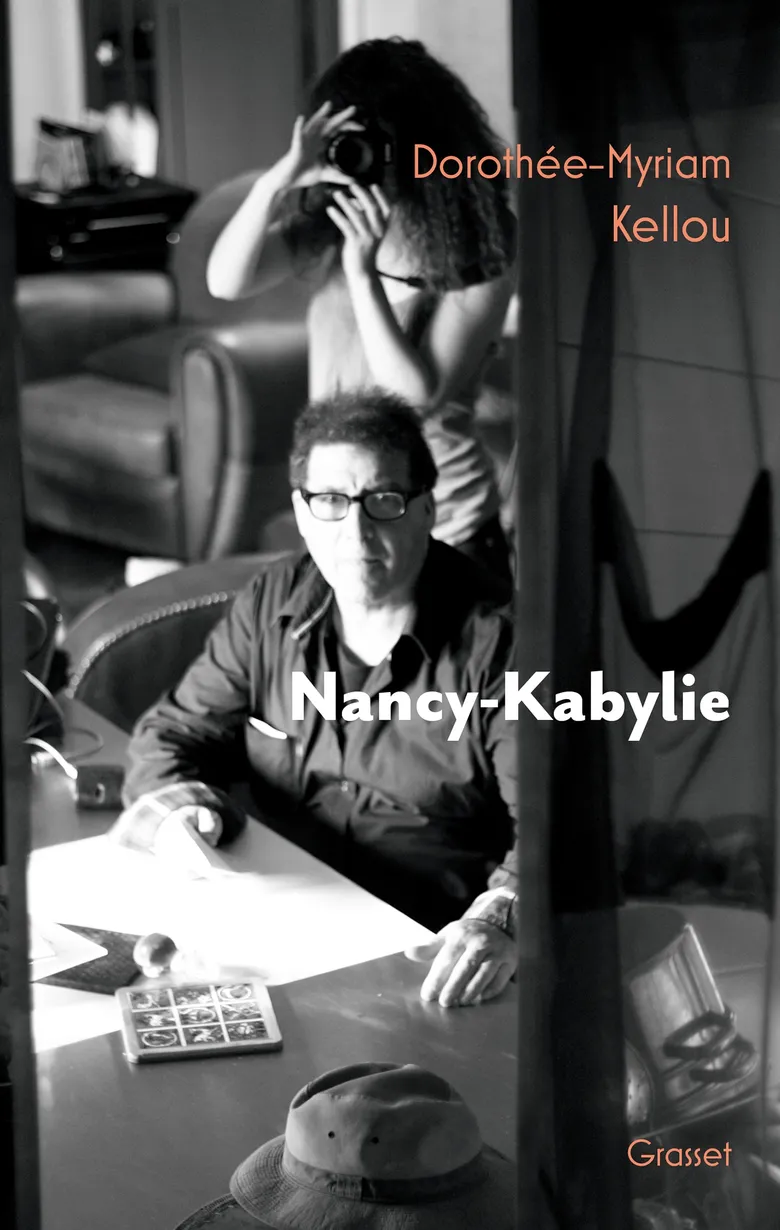
Plongez au cœur de ‘Nancy-Kabylie’, une création saisissante de Dorothée Myriam Kellou, où se déploie une réflexion sur la résilience de la transmission malgré les fractures infligées par l’exil et la brutalité des conflits.
Lire aussi cet Article… Entretien avec Mathilde de Télossie
INTERVIEW
Votre livre captive ses lecteurs au point que ma boîte mail regorge de messages élogieux à son sujet… Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ?
Ce livre est né du désir de raconter ce que je n’avais pas pu traduire dans mon film ‘A Mansourah tu nous as séparés’ (2019, Les Films du Bilboquet) et dans mon podcast ‘L’Algérie des camps’ (2020, France Culture).
Cette quête, devenue enquête au fil des ans, était si profonde et bouleversante émotionnellement que j’ai souhaité en faire un récit librement réimaginé qui pourrait dire ce qui se trame au plus intime de soi, lorsqu’on s’interroge sur les silences hérités de la période coloniale et qu’on s’y confronte.
Le titre de votre récit semble avoir une signification symbolique. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Nancy-Kabylie, deux points d’ancrage et de passage pour retrouver ces mémoires familiales et collectives enfouies. Il y a une expression en algérien que j’aime beaucoup. Lorsqu’on demande à quelqu’un de montrer son oreille, il passe son bras droit au-dessus de sa tête pour attraper son oreille gauche. Peut-être une manière de raconter le chemin de la vie, la route n’est jamais directe, on emprunte des détours.
Je ne suis pas allée directement de Nancy, où j’ai grandi enfant, à la Kabylie, où j’ai réalisé ce travail de mémoire sur les déplacements forcés de populations civiles pendant la guerre d’indépendance en Algérie.
J’ai pris des détours, étapes d’un long voyage intérieur et initiatique : de Nancy à Lyon, du Caire à la Palestine, de Washington à la Kabylie, de Paris à Alger, pour finalement revenir à Nancy…
Pourquoi avez-vous choisi de mêler la dimension intime de votre histoire familiale avec une approche documentaire pour évoquer cette période spécifique de l’Histoire ?
Le point de départ de ma quête devenue enquête est un questionnement très intime, profond. Mais je n’ai pas pu rester seule avec mes questions. J’ai eu besoin de sortir de moi, d’aller chercher des récits, des documents, voyager pour y répondre et comprendre que ma quête n’était pas que la mienne.
En chemin, j’ai rencontré tant de jeunes franco-algériens, africains, arabes, amérindiens etc… issus de peuples anciennement colonisés, qui se posent des questions sur une histoire collective coloniale héritée avec fracas.
Comment avez-vous sélectionné les souvenirs que vous avez partagés dans votre livre ? Y en a-t-il certains qui ont été particulièrement difficiles à évoquer ? Un moment où un souvenir vous a submergé d’émotions pendant l’écriture ?
Pendant toutes ces années, j’ai pris des notes dans un carnet. Quand j’ai commencé à écrire, j’ai relu ces pages et fermé les yeux. Des souvenirs se sont naturellement imposés à moi. Ils constituent ce que j’appellerai des souvenirs-pivots ou piliers. J’ai pris la liberté de les réécrire, de les mettre en scène. Ils constituent une matière créative très riche.
Le souvenir le plus douloureux, je l’évoque dans le chapitre « L’Algérie du vertige ». Mon père, chez lui, profondément absent, captif de la mélancolie, abîmé jusqu’au vertige.
J’ai souhaité comprendre pourquoi et, dans mon enquête, je l’ai compris. Derrière se cachait le trauma de l’exil.
Comment avez-vous perçu l’évolution de votre relation avec votre père tout au long de ce voyage ? Y a-t-il eu des moments de découverte ou de compréhension particulièrement significatifs pour vous ?
Au départ, mon père était silencieux. Quand il a commencé à écrire « Lettre à mes filles », un projet de film qu’il n’a pas tourné, je vivais à Jérusalem. J’étais confrontée chaque jour à la violence de l’occupation israélienne.
Il a commencé à s’ouvrir sur la brutalité de l’occupation française en Algérie. Mais ce n’est qu’aux États-Unis, lorsque j’ai réalisé mon master d’études arabes à l’Université de Georgetown, que j’ai commencé à lui poser des questions précises sur son histoire.
Au départ, il répondait par bribes. J’avais du mal à comprendre. C’est le retour à Mansourah, dans son village natal, près des siens, qui m’a permis de mieux saisir ce qui l’avait traversé.
La réalisation du film « À Mansourah tu nous as séparés », les nombreuses projections auxquelles il a assisté, m’ont permis de le connaître profondément. C’était beau de le voir raconter son histoire, enfin, devant un public nombreux et attentif, bienveillant. Ce sont ces espaces où la parole de l’autre, ancien colonisé, peut librement exister qui comptent.
Comment avez-vous géré la contradiction entre l’idéalisation de l’Algérie et la réalité de votre expérience une fois sur place ?
Quand on grandit en France, dans la fierté « DZ » « Djazaïr », « Algérie », une fierté nécessaire pour sortir de la honte des origines que beaucoup connaissent, on peut avoir tendance à idéaliser le pays des ancêtres, à l’abstraire de son histoire actuelle.
L’Algérie reste malheureusement un régime autoritaire, où la parole est encore trop souvent muselée. En vivant sur place, j’ai compris pourquoi mon père avait choisi l’exil douloureux de son pays. Il espérait s’exprimer, créer librement.
Mais la France était-elle prête, est-elle prête à entendre les histoires qui la dérange, la détrône ? De nombreux Français le sont. Ce sont eux qui constituent l’espoir de ce pays : placer les histoires confinées aux marges au centre et leur donner toute la considération qu’elles méritent.
Dans vos travaux, la guerre, les déplacements et l’identité semblent être des thèmes récurrents et puissants. Qu’est-ce qui suscite en vous cette révolte, ou encore, qu’est-ce qui nourrit ces inspirations ?
La révolte naît du silence intime et officiel autour de cette histoire, du manque de travail de reconnaissance. Les historiens ont pourtant beaucoup écrit, mais les politiques ne sont pas à la hauteur de la vérité historique.
En 2024, il n’y a toujours pas de consensus sur ce qu’était la colonisation. Était-ce une bénédiction comme voudraient nous le faire croire certains, ou un crime contre l’humanité ? Peut-être faudrait-il faire la synthèse, un crime qui a été une bénédiction pour certains ?
La musique a une place particulière dans votre cœur. Comment les chansons comme ‘La maman des poissons’ ont-elles influencé votre lien avec votre père et vos origines ?
Oui, la musique est essentielle. J’ai développé un goût pour les mots en français très tôt en écoutant les chansons ludiques de Boby Lapointe. Quand j’ai commencé à étudier l’arabe, j’ai beaucoup écouté les grands classiques, de Oum Kalthoum à Abdelhalim Hafez.
Un soir, j’ai écouté et compris une chanson de Fairouz, donne-moi ta flute et chante du poète Khalil Jibran. J’avais 20 ans. C’était si beau de percer le mystère des mots, d’en saisir le sens, que j’ai pleuré.
Comment votre approche pour ce livre se distingue-t-elle de vos précédents projets documentaires tels que ‘À Mansourah, tu nous as séparés’ et le podcast ‘L’Algérie des camps’, diffusé sur France Culture ?
Mon film posait la question des déplacements forcés de populations civiles en Algérie, qui ont touché plus de deux millions de « Français musulmans » pendant la guerre. Mon père était le fil rouge de l’histoire. Mon podcast interrogeait les conséquences de ce déracinement en masse à l’échelle du territoire algérien. Mon livre m’a permis de me raconter dans cette enquête et d’oser sortir d’une pudeur de rigueur, mais qui empêche de comprendre ce qui nous meut profondément dans ces quêtes, enquêtes.
L’écrivain contribue de manière significative à la préservation de la mémoire. Pouvez-vous partager comment cette responsabilité s’est manifestée pour vous personnellement pendant l’écriture de ce livre ?
Lorsque j’ai découvert l’histoire des camps de regroupement, j’ai cherché les écrits sur le sujet réalisés par des anciens colonisés. Il me manquait la parole de ceux qui l’avaient vécu, éprouvé dans leur chair. Lorsque j’ai été à Mansourah et recueilli la parole de ceux qui ne s’étaient jamais livrés, j’étais bouleversée. Je sentais une responsabilité, quasi accablante : faire exister la parole des silenciés par l’histoire et les pouvoirs.
Les auteurs ont souvent des rituels et des méthodes qui les aident à rester concentrés et productifs pendant l’écriture. Pourriez-vous nous décrire vos propres habitudes d’écriture et la manière dont vous avez géré la discipline nécessaire pour achever votre livre ?
Très bonne question. Je dirai qu’il faut se connecter à soi, avoir une chambre à soi, dirait Virginia Woolf, ou la possibilité de s’abstraire du réel et de penser. Une fois qu’on est rentré dans la transe de l’écriture, il est difficile d’en sortir. J’écrivais partout où l’inspiration me venait, dans un café, le métro, dans la rue. Je notais des mots qui pourraient déclencher ensuite un nouvel élan d’écriture pour un prochain chapitre.
Travailler avec une éditrice comme Pauline Perrignon chez Grasset m’a aussi beaucoup aidée. Elle m’a accompagnée au milieu de l’écriture et a su faire émerger l’essentiel, la quintessence de ce que je voulais dire. Qu’elle en soit à jamais remerciée !
Entretien réalisé le 16 janvier 2024.







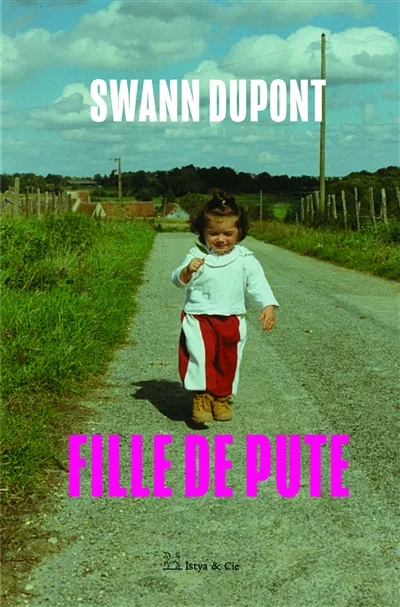

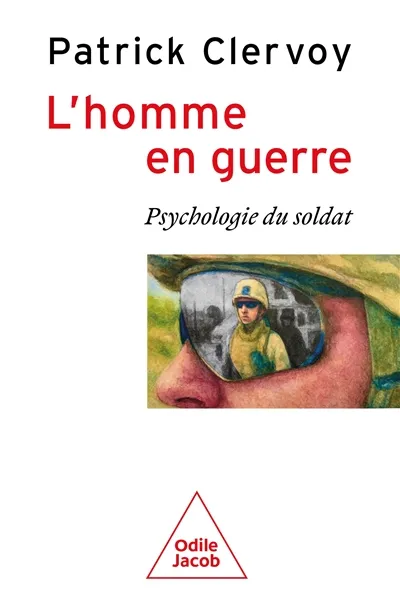








Laisser un commentaire