Mona Jafarian nous parle de son livre Mon combat, publié aux Éditions Stock.

..*..*..
Mona Jafarian est une activiste et conférencière franco-iranienne. Elle a cofondé l’association Femme Azadi, qui mène des actions politiques, médiatiques, événementielles et caritatives pour aider le peuple iranien dans sa révolution contre la République islamique.
..*..*..
… … …
Dans un monde secoué par l’incertitude et la violence, Mona Jafarian refuse de se taire.
Elle élève la voix, portée par une détermination sans faille.
Par son engagement, elle milite, agit et s’efforce de faire naître un espoir obstiné, malgré les tempêtes.
L’Iran vit en elle, à jamais.
Acheter le Livre Ici… Mon combat : Le livre Mona Jafarian
Lire aussi cet Article… Entretien avec Asya Djoulaït
INTERVIEW
Pourquoi ce livre, et pourquoi maintenant ?
J’ai consacré près d’une année à l’écriture de cet ouvrage. Mon intention première était de me concentrer sur mon engagement pour l’Iran, mais les événements et les dérives que j’observais en France m’ont conduite à élargir mon propos.
Au-delà de l’ignorance manifeste de l’histoire de l’Iran et de son peuple, j’ai été frappée par une dérive idéologique préoccupante au sein de certains mouvements féministes et militants. J’y ai vu s’affirmer une forme d’intégrisme inquiétante, une recrudescence de l’antisémitisme, ainsi qu’une remise en cause répétée de nos principes républicains et de laïcité.
Face à ce constat alarmant, j’ai ressenti la nécessité de m’adresser à cette majorité silencieuse, de lancer un appel clair et déterminé, pour que la parole se libère et que les valeurs qui nous rassemblent soient défendues avec force.
Ce livre, d’abord centré sur l’Iran, prend rapidement la forme d’un cri d’alerte lancé à la France. À quel moment cette bascule vous est-elle apparue comme nécessaire ?
Plus j’étais attaquée par des pseudo-féministes se réclamant de l’intersectionnalité, plus les menaces de mort et les insultes émanant d’intégristes présents en France se multipliaient. Parallèlement, je voyais certains partis politiques, tel que La France insoumise, instrumentaliser le conflit au Proche-Orient pour radicaliser les esprits, attiser les divisions et en tirer des bénéfices électoraux. Et plus je constatais ces dérives, plus je ressentais l’urgence de tirer la sonnette d’alarme.
Le contraste avec la jeunesse iranienne m’apparaissait de plus en plus saisissant, presque déroutant. Tandis que ces jeunes, au prix de leur liberté et parfois de leur vie, se battent pour la laïcité, pour l’émancipation, pour l’universalisme et pour la lumière, je voyais, ici, l’obscurantisme infiltrer nos écoles, nos universités, nos rues et même nos médias. Ce décalage profond m’a convaincue qu’il était temps de prendre la parole, de dénoncer sans détour ce que beaucoup se refusent à nommer.
Parlez-nous de l’Iran. L’Iran reste, pour beaucoup, une énigme. Dans les médias occidentaux, le pays est souvent réduit à des caricatures. Qu’est-ce que nous continuons obstinément à ne pas comprendre ?
Depuis près de trois ans, j’entends tout et son contraire à propos de mon peuple, de mon pays natal et de notre histoire. Trop souvent, je me heurte à un paternalisme condescendant émanant de celles et ceux qui prétendent nous dicter ce que nous devrions penser ou dire. Certains n’hésitent pas à nous accuser d’islamophobie, voire de fascisme, simplement parce que nous dénonçons et combattons l’une des formes les plus radicales et destructrices de l’islamisme.
Face à cette inversion des valeurs et à cette méconnaissance abyssale de notre réalité, j’ai ressenti un besoin viscéral : celui de rappeler à tous comment l’Iran a basculé en 1979, comment l’alliance mortifère entre marxistes-léninistes et religieux a précipité la chute de notre pays dans l’obscurantisme et la barbarie. Ce rappel n’est pas un retour sur le passé par nostalgie, mais un devoir de mémoire, pour mieux comprendre le présent et éviter que l’histoire ne se répète ailleurs.
Vous revendiquez un attachement profond à la laïcité. De façon concrète, ou avec un exemple précis, en quoi cette notion vous paraît-elle aujourd’hui mal comprise ou affaiblie en France ?
Lorsque l’on a été témoin de ce que produit la religion lorsqu’elle s’empare du pouvoir, on apprend à chérir, plus que quiconque, la laïcité à la française. C’est une conviction forgée dans l’expérience, dans la douleur, et dans l’exil. J’entends souvent certains affirmer que la laïcité serait un prétexte pour stigmatiser les musulmans. Et cela me révolte. Car sans laïcité, il n’y a ni droits des femmes, ni droits humains tout court.
Nous vivons dans une société où l’on a fini par banaliser certains outils d’oppression, tels que le hijab, au nom du respect des cultures ou des croyances. Et trop souvent, ceux qui défendent ces symboles au nom du « vivre ensemble » ne réalisent pas que sans cette laïcité qui m’est si chère, ces mêmes femmes n’auraient, juridiquement et socialement, que la moitié de la valeur d’un homme.
La laïcité, ce n’est pas une idée abstraite. C’est ce qui nous permet de penser, de croire ( ou de ne pas croire ) en toute liberté. Elle est, à mes yeux, le socle inaltérable de notre République. Et reculer ne serait-ce que d’un pas sur ce terrain, c’est ouvrir la porte aux dérives les plus dangereuses.
Des dérives que je constate chaque jour. Je reçois quotidiennement de nombreux témoignages de professeurs, de parents, de citoyens inquiets. Ce qu’ils vivent, ce qu’ils voient dans leurs établissements, dans leurs quartiers, dans leurs lieux de travail, devrait nous alerter collectivement.
Car ce n’est plus marginal, ni anecdotique. C’est une réalité qui s’installe, insidieuse, normalisée. Une réalité où l’intégrisme, avec une habileté redoutable, instrumentalise nos valeurs démocratiques pour mieux les détourner, les affaiblir, et finalement imposer des visions du monde radicalement opposées à notre idéal d’universalisme.
C’est précisément pour cela que la laïcité doit rester notre boussole. Elle est la condition de possibilité du vivre ensemble, la digue contre les pressions communautaristes, le rempart contre toutes les formes de domination. L’oublier ou la trahir, c’est ouvrir la voie à une société fracturée, soumise, divisée.
Votre engagement vous expose à des critiques virulentes. Est-ce en France ou en Iran que vous vous sentez la plus vulnérable ? Quelles conséquences cela a-t-il eues sur votre parole publique, par exemple ?
Je ne peux pas vous dire si je me sens plus vulnérable ici ou là-bas, car, en réalité, je n’ai plus la possibilité de retourner en Iran. Mon activisme m’en a définitivement éloignée. Si je devais y mettre les pieds, je serais immédiatement arrêtée, emprisonnée, puis probablement condamnée à mort. Même les pays frontaliers me sont interdits : le risque d’enlèvement ou d’assassinat y est trop élevé. En France, je vis sous protection policière.
Mais cette sécurité apparente en France n’efface pas la violence que je subis, ici même. Les menaces, les insultes, les tentatives d’intimidation, les campagnes de diffamation ( y compris de la part de certaines féministes d’extrême gauche qui, consciemment ou non, sont devenues les idiotes utiles de l’islamisme ) témoignent d’un climat qui se dégrade rapidement. Ce que j’observe, ce que je vis, je l’ai documenté avec rigueur, et tenté de l’expliquer dans ce livre, dans l’espoir de provoquer un sursaut, un éveil des consciences.
Car la jeunesse est en première ligne. Elle est la cible privilégiée de cet endoctrinement idéologique qui se répand à bas bruit. Il me paraissait essentiel de rappeler à quel point les événements en cours au Proche et au Moyen-Orient influencent directement notre présent, et plus encore, l’avenir de nos démocraties.
Et au cœur de ce combat, il y a l’Iran. La République islamique n’est pas seulement le bourreau de son propre peuple ; elle est aujourd’hui le principal financier du terrorisme mondial, un acteur central de la montée de l’intégrisme et de l’antisémitisme. C’est pourquoi la victoire du peuple iranien n’est pas une question régionale : c’est un enjeu universel. C’est une condition essentielle à la paix, à la liberté, à l’émancipation et à notre sécurité.
Vous êtes très critique envers une certaine gauche. S’agit-il d’une rupture politique assumée ou d’une blessure plus intime ? Et, plus largement, que peut encore faire la gauche — en France comme en Iran — face aux ayatollahs ?
Vous savez, ces militants d’ultra-gauche se plaisent à me qualifier de « sale fasciste islamophobe d’extrême droite », et cela m’arrache presque un sourire tant l’accusation est absurde. Je suis de gauche. Ou plutôt, je l’étais. J’emploie désormais le passé, car ma gauche à moi était universaliste, laïque, républicaine. Une gauche de principes, une gauche de lumière. Et si ma colère est aujourd’hui si vive, c’est précisément parce que j’y ai cru. Parce que mon cœur, autrefois, battait à gauche.
Aujourd’hui, j’ai honte de ce qu’est devenue cette gauche. Un paillasson idéologique pour La France insoumise et sa stratégie populiste, une force qui, sous couvert de lutte sociale, a pactisé avec les pires compromissions. J’ai longuement documenté cette dérive dans mon livre. Les liens entre LFI et l’islamisme, leur cynisme électoraliste devenu un danger majeur pour notre République, ne peuvent plus être ignorés. À mes yeux, ils ont quitté l’arc républicain. Ils sont aujourd’hui soutenus par des médias d’extrême droite négationnistes comme Rivarol ou défendus par des personnalités comme Alain Soral tant ils ont fait de l’antisémitisme un moteur électoral. Leurs idées, qui fracturent notre société et nourrissent l’obscurantisme, doivent être combattues avec détermination.
Beaucoup d’Iraniens, vous savez, haïssent ce qu’ils appellent « la gauche » qu’ils tiennent pour responsable de la chute de l’Iran en 1979. Longtemps, je ne transposais pas ce ressentiment qu’ils avaient sur la situation en France . J’y voyais une lecture trop simpliste, trop lointaine de ce que représentait la gauche en France, comparée aux mouvements gauchistes iraniens. Mais aujourd’hui, je comprends ce qu’ils dénoncent. Parce que je reconnais, ici, les mêmes discours, les mêmes mécanismes, les mêmes complicités.
C’est un jeu dangereux. Un jeu qui pourrait nous coûter cher. J’espère, sincèrement, qu’un jour la gauche saura se redresser, retrouver ses repères, ses valeurs. Mais tant qu’elle restera dans cette dérive, je ne peux plus, en conscience, m’y reconnaître.
Parlez-nous de vous. Votre trajectoire vous situe entre deux mondes. Avez-vous le sentiment de n’appartenir totalement ni à l’un ni à l’autre ? Est-ce un combat de femme, d’exilée, ou d’héritière d’une histoire brisée… ou tout cela à la fois ? ?

Vous savez, lorsque l’on porte en soi deux cultures, deux patries, on est à la fois chez soi partout… et nulle part tout à fait.
En France, on me perçoit souvent comme iranienne. On me dit, presque étonné, que je parle « très bien français », alors que je suis arrivée ici enfant.
Et en Iran, j’étais cette « petite Française », à qui l’on disait avec bienveillance que je parlais remarquablement bien le persan… pour une « khâredji », une étrangère.
Mais je n’ai jamais souffert de cette double appartenance.
Au contraire, elle a toujours été pour moi une richesse, un pont. Une chance de faire connaître l’Iran à la France, et la France à l’Iran. Car au fond, ces deux peuples, si éloignés géographiquement, partagent tant de valeurs essentielles : l’amour du savoir, de la lumière, de la poésie, de la culture, de la musique, de l’art… et surtout cet attachement profond à la laïcité et à l’universalisme.
Mon père n’a jamais quitté l’Iran. Toute ma vie, j’ai fait des allers-retours entre ces deux pays. Chez nous, on vivait à l’iranienne : on parlait persan, on cuisinait iranien, on portait en nous les traditions et la mémoire. Et dès que je sortais de la maison, j’étais française. Il n’y avait aucune contradiction, aucune fracture. Ma mère, elle, nous a élevés avec une immense gratitude envers la France, ce pays qui nous avait offert la liberté qu’elle avait perdue dans le sien.
Mon iranité est profondément ancrée en moi. Et c’est tout naturellement, presque instinctivement, qu’à la mort de Mahsa Amini, j’ai ressenti le besoin de m’engager. C’était une évidence. C’était vital. Parce qu’à ce moment-là, ce n’était pas seulement une jeune femme qui était tombée — c’était tout un peuple qui se levait. Et je ne pouvais pas rester silencieuse.
Un lien du Journal Le Monde… « Femme, vie, liberté »
Le slogan « Femme, vie, liberté » a franchi les frontières. Que signifie-t-il pour vous aujourd’hui, ici, dans un contexte français ?
Le slogan Femme, Vie, Liberté a, certes, franchi les frontières, ému le monde, inspiré des élans de solidarité. Mais il n’a pas reçu le soutien qu’on espérait. Même les grands mouvements féministes, si prompts à se mobiliser ailleurs, ne nous ont jamais véritablement rejoints. Quant aux dirigeants occidentaux, ils ont persisté dans une posture de prudence, refusant d’agir concrètement en faveur du peuple iranien, préférant maintenir une politique de négociation et d’apaisement face au régime de Téhéran.
Dans mon livre, je prends le temps de revenir sur la portée réelle de ce soulèvement. Trop souvent, on l’a réduit à une lutte contre le voile obligatoire. Les Iraniens et les Iraniennes ne réclament pas des réformes : ils veulent le renversement pur et simple d’un régime oppressif, corrompu, terroriste et théocratique. Et dans cette quête de liberté, ils sont tragiquement seuls.
L’Iran ne fait la une que lorsqu’il est associé à Israël, ou lorsqu’une femme est filmée en sous-vêtements, images immédiatement reprises en boucle par les médias. Mais la lutte quotidienne, l’endurance héroïque de ce peuple, elle, reste largement ignorée. Pourtant, elle est essentielle, pas seulement pour l’Iran, mais pour nous tous. Car les valeurs pour lesquelles les Iraniens se battent sont précisément celles que nous avons en Occident et qui sont attaquées : la liberté de penser, la laïcité, l’égalité.
Un véritable axe de déstabilisation s’est constitué : entre la République islamique d’Iran, ses proxys terroristes, le Qatar, la Russie et la Chine. Cet axe a une stratégie, une vision à long terme, et il s’attaque directement à nos démocraties, à nos institutions, à notre modèle de société.
Notre révolution dépasse désormais le cadre du slogan Femme, Vie, Liberté. C’est une guerre entre la lumière et l’obscurantisme. Et mon livre est un appel : un appel à la lucidité, un appel au courage, un appel au soutien. Parce que la victoire du peuple iranien est bien plus qu’un espoir pour le Moyen-Orient. C’est une nécessité pour l’avenir même de nos sociétés libres.
Le voile, en France, cristallise des tensions multiples. Il est parfois brandi comme étendard, parfois dénoncé comme oppression. Comment vous situez-vous, personnellement et politiquement, face à cet objet devenu hautement symbolique ?
Le voile est, aujourd’hui, le symbole le plus visible de l’islamisme. C’est l’étendard de la charia, des lois islamiques qui, partout où elles s’imposent, réduisent les libertés, et plus particulièrement celles des femmes. Le voile n’est ni un signe de liberté, ni d’émancipation, ni un progrès social. C’est au contraire un marqueur de régression, un signal fort du recul de notre modèle égalitaire.
Il ne s’agit pas d’un simple accessoire vestimentaire, ni d’un choix anodin. Ce n’est ni une casquette, ni un foulard. C’est un signe d’adhésion, volontaire ou imposée, à une hiérarchie sociale et juridique profondément patriarcale. C’est un marqueur de soumission à une autorité divine qui dicte, par voie de conséquences, toute une série de normes contraires aux principes républicains. Porter le voile, dans les pays qui appliquent la charia, c’est accepter une série de réalités : être considérée consommable dès la puberté, hériter ou témoigner pour moitié par rapport à un homme, dépendre d’un tuteur masculin, ne pas pouvoir voyager librement, n’avoir que peu de droits sur ses propres enfants, tolérer la polygamie, nier le viol conjugal et tant d’autres violences institutionnalisées.
Alors je pose une question sincère : toutes ces jeunes filles qui, en France, se voilent par revendication identitaire, ou parfois pour être « respectées » dans un environnement communautaire oppressant, réalisent-elles ce que cela signifie, dans sa logique ultime ? Comprennent-elles ce qui découle, historiquement et juridiquement, de l’application réelle du Coran ? Ont-elles mesuré la chance immense qu’elles ont de vivre dans une République laïque, qui les protège même malgré elles ?
Je ne combats pas les femmes voilées. Je combats, avec toute ma force, l’idéologie qui leur fait croire qu’il faut valoir la moitié d’un homme pour mériter le respect. Et pour combattre cette idéologie, il ne suffit pas d’interdire les abayas dans les établissements scolaires. Il faut aller à la racine. Il faut des politiques ambitieuses, cohérentes, courageuses. S’attaquer aux réseaux d’endoctrinement. Il faut oser dire les choses. Ne plus trembler à l’idée d’être accusée d’islamophobie, souvent utilisée pour réduire au silence ceux qui savent et dénoncent.
Non, le voile ne sera jamais un manifeste féministe. Non, l’islam politique ne peut pas être une voie d’émancipation. Dire cela n’est ni fasciste, ni scandaleux. C’est au contraire une vérité salutaire. Une vérité qu’il faut marteler pour rappeler une réalité implacable : aucun pays régi par l’Islam ne respecte les droits fondamentaux des femmes. Pas un seul.
Si une jeune femme, en Iran ou dans une banlieue française, lisait votre livre, qu’aimeriez-vous qu’elle en retienne ? Une phrase, une force, un espoir ?
Si une femme en Iran lisait mon livre, je pense qu’elle me dirait simplement : merci. Merci de faire entendre sa voix au-delà des frontières, de faire savoir au monde pour quoi elle se bat et de porter la richesse de notre culture et la dignité de notre peuple.
Et pour cette jeune femme, ici, en banlieue, j’espère surtout qu’elle le lira. Mon intention n’est pas de juger ni de heurter. Je sais que mes mots peuvent bousculer, remettre en question, déranger même. Peut-être que certaines pages éveilleront en elle de la colère. Mais si cette lecture lui permet, ne serait-ce qu’un instant, d’élargir son regard, de s’interroger sur les réalités du Moyen-Orient : ce que vivent réellement les femmes là-bas mais aussi sur la réalité géopolitique et historique de la région, alors ce sera déjà une victoire. Car tout n’est pas comme on le croit. Tout n’est pas comme on le dit. Et parfois, il suffit d’un livre pour commencer à voir autrement.
#MonaJafarian #Iran #Laïcité #DroitsDesFemmes



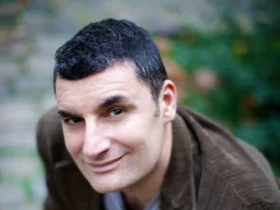




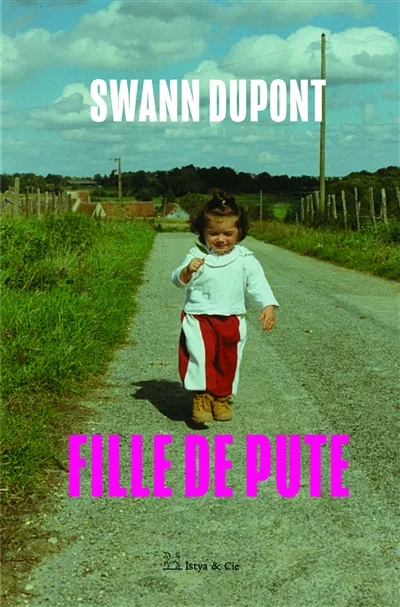

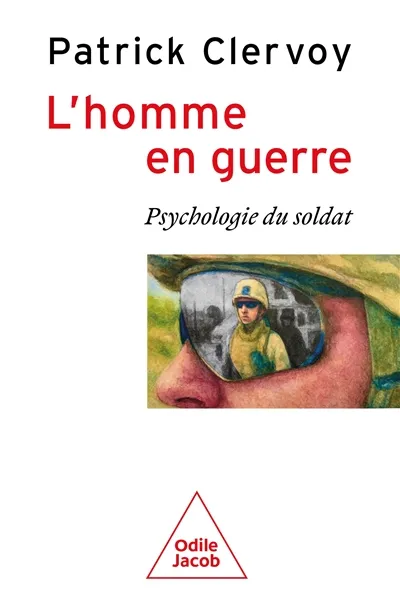








Laisser un commentaire